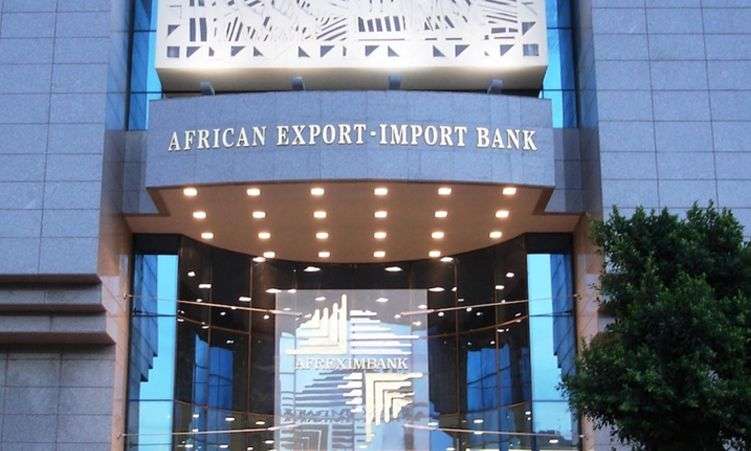Burkina : Près de 14 000 décès maternels et périnataux recensés en 2025, alerte sanitaire.
Le ministère de la Santé du Burkina et les médias nationaux sonnent l’alarme : entre décès maternels, mort-nés et décès néonatals précoces, le bilan partiel de l’année 2025 approche les 14 000 cas. Si les chiffres varient selon les sources et les périodes couvertes, l’ampleur du phénomène confirme une urgence sanitaire majeure et met en lumière les faiblesses du système de surveillance et de prise en charge périnatale.
Un bilan lourd, consolidé par plusieurs sources locales
Plusieurs médias nationaux et panafricains relayent un constat convergent : de la semaine 1 à la semaine 42 de 2025, les autorités sanitaires ont enregistré des milliers de cas tragiques — des centaines de décès maternels, des milliers de mort-nés et des milliers de décès néonatals précoces. Selon les informations reprises par Sidwaya et APAnews, le total cumulé des décès maternels et périnataux dépasse les 13 000 pour la période considérée, ce qui conduit les commentateurs à évoquer une fourchette « proche de 14 000 » pour l’année en cours s’il n’y a pas de retournement rapide de tendance. (Sources : Sidwaya, APAnews, LeFaso).
Décomposition du phénomène : où se concentrent les pertes humaines ?
Les publications locales donnent une image plus précise, bien que partielle :
- Décès maternels (femmes décédées au cours de la grossesse, de l’accouchement ou en post-partum immédiat) : plusieurs centaines recensés jusqu’à la 42ᵉ semaine.
- Mort-nés : des milliers d’enfants nés sans vie, chiffre particulièrement élevé selon les rapports cités.
- Décès néonatals précoces (dans les jours suivant la naissance) : plusieurs milliers également, contribuant fortement au total agrégé.
Cette combinaison — décès maternels + mort-nés + décès néonatals précoces — explique que le bilan consolidé atteigne des niveaux extrêmement préoccupants.
Pourquoi ces chiffres sont-ils si élevés ? Causes et facteurs aggravants
Les auteurs des bilans et experts locaux pointent plusieurs facteurs structurants :
- Accès insuffisant aux soins obstétricaux de qualité : centres de santé souvent dépourvus d’équipements, de personnels formés ou de sang et médicaments essentiels.
- Retards dans la prise en charge : difficultés d’acheminement des femmes en travail vers des structures adaptées (routes, transport, coûts).
- Surveillance périnatale incomplète : en zones rurales, les décès peuvent être sous-déclarés ou déclarés tardivement, rendant la statistique nationale difficile à consolider en temps réel.
- Contexte sécuritaire et économique : insécurité, déplacements de populations et contraintes budgétaires qui fragilisent les systèmes locaux de santé.
Ces facteurs, combinés, créent un terreau où les complications obstétricales et néonatales aboutissent plus souvent au pire qu’ailleurs.
Les limites des chiffres : prudence et transparence
Il est important de souligner les zones d’ombre : les chiffres publiés à la date de la couverture (jusqu’à la semaine 42) ne constituent pas forcément le bilan définitif de 2025. Les médias locaux et le ministère parlent d’ensembles consolidés mais parfois partiels — les statistiques finales seront affinées lorsque le ministère de la Santé publiera son rapport annuel complet.
Autre point : la répartition exacte entre décès maternels, mort-nés et décès néonatals varie selon les sources et selon les méthodes de collecte. Ces différences méthodologiques expliquent en partie les écarts observés entre estimations.
Quelles réponses immédiates et structurelles ?
Plusieurs pistes d’action sont régulièrement proposées par les acteurs de santé et les observateurs :
- Renforcement des capacités des maternités (personnel formé en obstétrique, disponibilité d’oxygène, sang, traitement des hémorragies, césariennes en urgence).
- Amélioration de la chaîne logistique (transport des patientes, réseaux de référence entre structures rurales et centres de niveau supérieur).
- Renforcement de la surveillance et de l’enregistrement des décès pour disposer de données fiables et ciblées sur les causes.
- Programmes communautaires pour encourager la consultation prénatale précoce et les accouchements assistés.
- Coordination humanitaire dans les zones touchées par l’insécurité pour maintenir l’accès aux soins.
Ces mesures exigent à la fois ressources, volonté politique et coopération internationale.
Derrière les statistiques — 13 000, 14 000, chiffres partiels — il y a des familles brisées et des maternités débordées. Si le Burkina veut inverser la courbe, il faudra plus que des bilans : une mobilisation durable des moyens et une politique publique qui mette la mère et le nouveau-né au centre des priorités. Sans cela, les chiffres resteront des chiffres, et non des vies sauvées.
La Rédaction