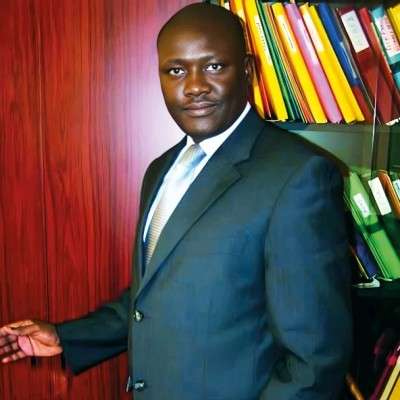Appel public à l’épargne en zone OHADA : Un levier puissant, mais sous haute surveillance.
Dans un contexte où le financement des entreprises africaines reste un défi majeur, l’appel public à l’épargne apparaît comme une alternative prometteuse. Pourtant, dans l’espace OHADA, cette pratique est encadrée par des règles strictes, parfois dissuasives, qui freinent son plein essor. Décryptage.
Un dispositif juridique continental
Mobiliser des fonds auprès du public pour financer une activité économique n’est pas un acte anodin. En Afrique de l’Ouest et du Centre, cette opération est encadrée par le droit OHADA à travers une procédure dite d’appel public à l’épargne. Adopté pour garantir la protection des investisseurs et la transparence du marché, ce dispositif vise à organiser, encadrer et sécuriser les levées de fonds à large échelle.
En clair, toute offre d’actions ou de titres de créance dépassant 50 millions de FCFA et s’adressant à plus de 100 personnes entre automatiquement dans le champ de cette réglementation. L’objectif est de soumettre les émetteurs à des obligations d’information et de transparence avant qu’ils ne collectent de l’argent auprès du grand public.
Le cadre OHADA est aujourd’hui en vigueur dans 16 pays africains, couvrant à la fois la zone UEMOA, la zone CEMAC, ainsi que la Guinée et les Comores.
Un visa obligatoire pour faire appel à l’épargne
Le texte de l’article 19 du règlement OHADA est explicite : tout appel public à l’épargne doit recevoir l’autorisation du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) via l’octroi d’un visa réglementaire.
Trois cas sont principalement visés :
- La dissémination de titres auprès d’au moins 100 personnes n’ayant aucun lien juridique entre elles ;
- Le recours à des procédés de communication de masse (publicité, démarchage) dans l’espace UEMOA ;
- L’inscription des titres à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Le message est clair : toute sollicitation du public pour financer une entreprise ou un projet doit respecter les règles, sous peine de sanctions.
Startups et plateformes : le cadre inadapté du financement participatif
Si cette rigueur réglementaire vise à protéger les épargnants et à encadrer les levées de fonds, elle peut se révéler contre-productive pour les jeunes entreprises innovantes, notamment dans le domaine du numérique et de la fintech.
En Côte d’Ivoire, par exemple, plusieurs initiatives de financement participatif (crowdfunding) ont vu le jour — à l’image de Happybenky ou Orange Collecte — avant de disparaître, faute de cadre juridique adapté. Le paradoxe est saisissant : alors que le crowdfunding est en plein essor dans le monde, son développement en Afrique francophone se heurte à l’absence d’un statut clair et souple pour ces nouveaux modes de financement.
Résultat : les startups locales, souvent exclues du crédit bancaire, se retrouvent face à un double verrou. D’un côté, elles ne peuvent légalement pas mobiliser de petits investissements auprès d’un large public sans visa. De l’autre, elles n’ont pas accès aux grandes plateformes internationales sans relais local solide.
Un droit à la transparence… mais aussi à l’innovation
Le cadre OHADA n’est pas figé. Il est l’un des plus ambitieux en matière d’intégration juridique sur le continent africain, et son objectif reste louable : garantir un marché sain, transparent et digne de confiance. Mais il pose aujourd’hui la question de l’équilibre entre encadrement et innovation.
Peut-on exiger des porteurs de projets modestes les mêmes démarches que des multinationales cotées ? Faut-il continuer à soumettre les startups à des procédures longues et coûteuses pour quelques millions de francs CFA levés en ligne ? Autant de questions qui méritent d’être posées à l’heure où l’Afrique cherche à soutenir son entrepreneuriat jeune et numérique.
En attendant, mieux vaut s’abstenir
En l’absence de cadre spécifique pour le financement participatif dans l’espace OHADA, un message prévaut pour les entrepreneurs, les porteurs de projets et même les associations : « ne répondez pas à l’appel », s’il n’est pas réglementé.
L’appel public à l’épargne est un levier puissant, mais il est strictement encadré. De Bamako à Douala, de Cotonou à Libreville, une seule règle prévaut : respecter la loi ou s’exposer à de lourdes sanctions.
La rédaction